Dr. Marco V. Benavides Sánchez.
L’intelligence artificielle (IA) n’est plus une technologie du futur : elle transforme déjà en profondeur le monde de la santé. De l’aide au diagnostic à la prédiction de l’évolution des maladies, en passant par le traitement et la classification de pathologies complexes, les algorithmes intelligents occupent une place croissante dans les pratiques médicales.
L’article Scientifique publié en 2025 par Vedat Çiçek et Ulas Bagci dans la revue Artificial Intelligence in Medicine explore avec clarté cette transformation majeure. Il soulève également trois questions fondamentales sur l’avenir de l’IA dans le domaine de la santé : quelle sera sa place ? Quelle relation s’instaurera entre médecins, patients et IA ? Et comment orienter les recherches pour répondre aux vrais défis sanitaires de la planète ?
Une technologie aux retombées économiques colossales
Selon un rapport cité par les auteurs, 6,6 milliards de dollars ont été investis dans l’IA en santé en 2021, et ces investissements devraient générer jusqu’à 150 milliards de bénéfices pour l’économie américaine d’ici 2026. Ce chiffre, impressionnant, reflète un changement de paradigme. L’IA n’est plus perçue comme un gadget technologique, mais comme un levier stratégique de transformation, capable d’optimiser les systèmes de soins, de réduire les coûts et d’améliorer les résultats cliniques.
Une popularité croissante dans des domaines clés
L’article souligne que l’intelligence artificielle est particulièrement utilisée dans cinq grands domaines médicaux :
- Le diagnostic, où des algorithmes sont capables de détecter des anomalies dans des images médicales (scanner, IRM, radiographies) avec une précision parfois supérieure à celle des radiologues.
- Le pronostic, avec des outils capables de prévoir l’évolution d’une maladie chez un patient donné.
- La classification des maladies, notamment grâce à des techniques d’apprentissage automatique qui analysent de grands ensembles de données pour identifier des sous-types de pathologies.
- La thérapie, où l’IA est utilisée pour guider les traitements, personnaliser les plans de soins, voire assister les chirurgiens en temps réel.
- La prédiction de la survie, particulièrement utile en oncologie ou en cardiologie, pour estimer les chances de guérison ou de rémission.
Ces avancées montrent à quel point l’IA peut devenir un partenaire précieux du personnel médical. Mais cette évolution rapide amène aussi de nouvelles interrogations.
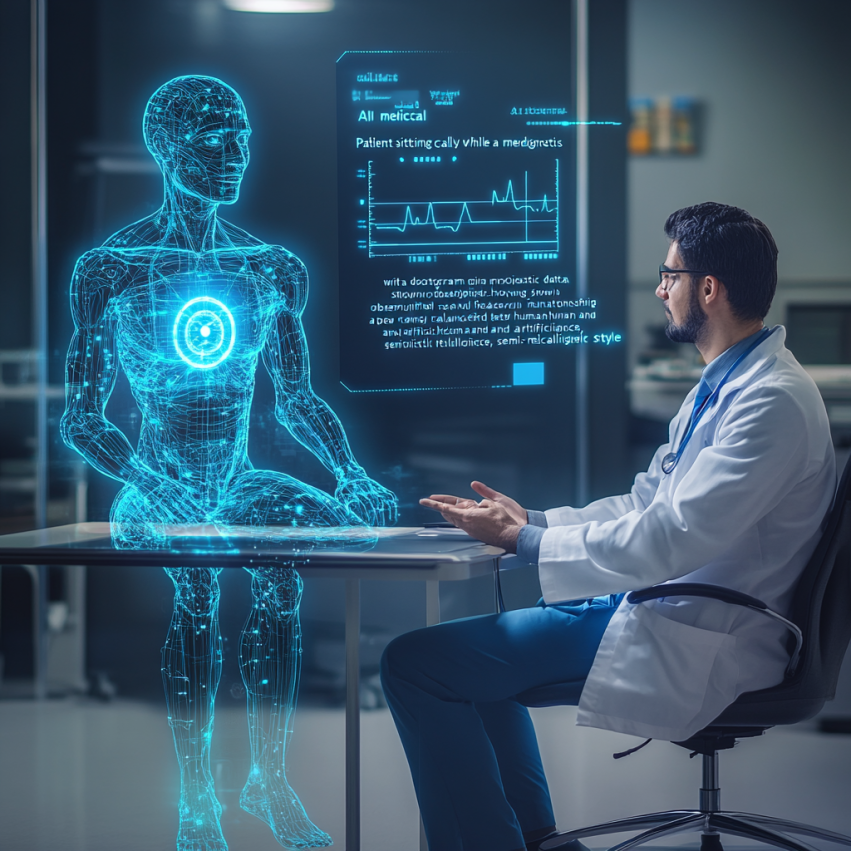
Où se situera l’IA dans la santé de demain ?
C’est la première grande question posée par Çiçek et Bagci. Si l’IA continue à s’intégrer à chaque étape du parcours de soin, faut-il la considérer comme un simple outil d’aide à la décision, ou comme un acteur autonome du système de santé ? Déjà aujourd’hui, certaines décisions cliniques sont influencées par les recommandations d’algorithmes. Dans un futur proche, verra-t-on des consultations médicales menées en partie, voire entièrement, par des agents intelligents ?
Les auteurs suggèrent qu’une clarification sera nécessaire sur le rôle exact de l’IA. Une régulation éthique et juridique devra encadrer son usage pour éviter les dérives, garantir la sécurité des patients et préserver la responsabilité des professionnels de santé.
Quel type de relation entre médecins, patients et IA ?
La deuxième question, tout aussi cruciale, concerne la nature des interactions humaines dans un monde médical dominé par l’IA. La relation médecin-patient est fondée sur l’écoute, la confiance et l’empathie — des qualités que les machines ne possèdent pas. Même si les intelligences artificielles peuvent imiter certaines formes de dialogue ou d’émotion, elles ne remplacent pas l’expérience humaine.
Les chercheurs s’interrogent donc : comment définir un nouveau modèle de collaboration, où les médecins travailleraient main dans la main avec l’IA, sans être remplacés ni déshumanisés ? Et comment préparer les patients à interagir avec ces technologies, en leur expliquant leurs limites et leur fonctionnement ?
Il sera essentiel d’accompagner cette transition par une éducation médicale adaptée, une sensibilisation du public et un cadre éthique robuste. La technologie ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un amplificateur des capacités humaines.
Vers une IA orientée sur les besoins mondiaux en santé
Enfin, la troisième question soulevée par l’article est profondément politique et humanitaire : comment orienter les recherches en IA pour répondre aux véritables problèmes de santé mondiaux ? La majorité des innovations en IA sont aujourd’hui développées dans les pays riches, pour des pathologies fréquentes dans ces régions (cancers, maladies cardiovasculaires, troubles métaboliques).
Mais qu’en est-il des besoins des pays à faible revenu ? Des maladies tropicales ? De la santé maternelle en zones rurales ? Si l’on veut que l’IA contribue réellement à l’amélioration de la santé globale, il faut veiller à ce que les recherches tiennent compte de la diversité des contextes sanitaires, et pas seulement des marchés les plus lucratifs.
Les auteurs appellent à une « démocratisation » de l’IA en santé : des bases de données ouvertes, des partenariats Nord-Sud, et une approche centrée sur les besoins des populations plutôt que sur la performance technologique seule.

Une révolution à accompagner avec lucidité
L’article de Çiçek et Bagci ne se contente pas de célébrer les succès de l’intelligence artificielle dans le domaine médical. Il propose une analyse lucide et nuancée, qui invite à une réflexion collective sur les transformations en cours. Oui, l’IA peut sauver des vies, améliorer les diagnostics, réduire les coûts et accélérer la recherche. Mais elle ne résoudra pas tous les problèmes seule. Sans cadre éthique, sans gouvernance partagée, et sans vigilance citoyenne, elle pourrait aussi aggraver certaines inégalités ou produire des effets non désirés.
En d’autres termes, la révolution de l’IA en santé ne doit pas être subie, mais pensée, orientée et encadrée.
Conclusion
L’intelligence artificielle s’impose comme un acteur incontournable de la médecine contemporaine et future. L’article de Vedat Çiçek et Ulas Bagci nous rappelle que son intégration dans les systèmes de santé doit s’accompagner d’une réflexion profonde sur sa place, ses usages, ses limites et son orientation. La question n’est plus de savoir si l’IA transformera la médecine, mais comment elle le fera — et pour qui.
La santé du futur dépendra autant de nos choix technologiques que de nos choix humains.
Article original
- Çiçek, V., & Bagci, U. (2025). Position of artificial intelligence in healthcare and future perspective. Artificial Intelligence in Medicine, 140, 103193. https://doi.org/10.1016/j.artmed.2025.103193
#ArtificialIntelligence #Medicine #Surgery #Medmultilingua


Laisser un commentaire